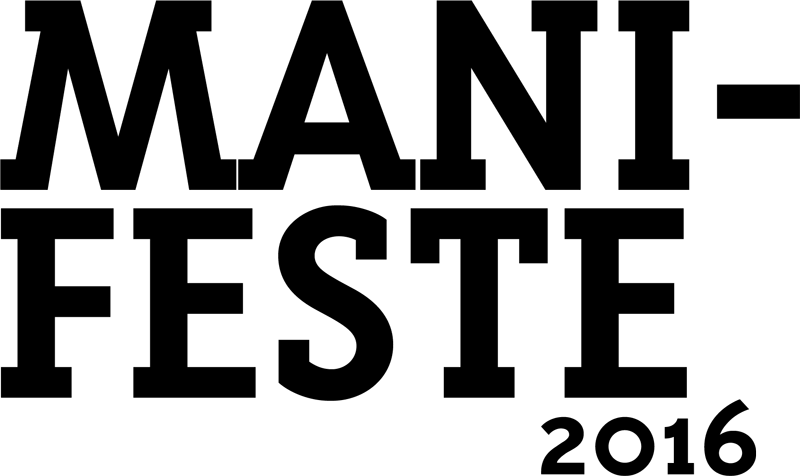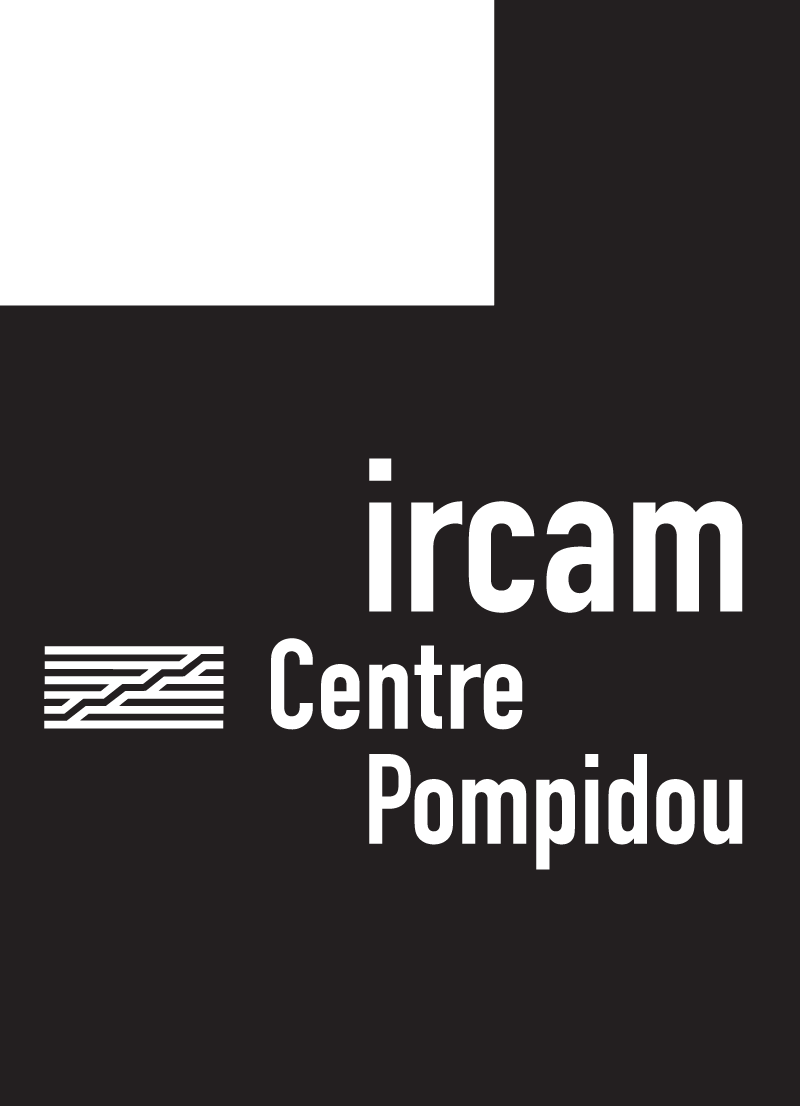Entretien avec Laurent Mariusse : la magie du marimba
published on June 24, 2016
Propos recueillis par Jérémie Szpirglas, journaliste et écrivain
 Laurent Mariusse, vous êtes à l’initiative de ce programme original autour du marimba cinq octaves : d’où vous est venue l’idée ?
Laurent Mariusse, vous êtes à l’initiative de ce programme original autour du marimba cinq octaves : d’où vous est venue l’idée ?
Laurent Mariusse : Tout est parti de la commande de Secret Dialogues, passée à James Wood par un consortium de marimbistes dont je fais partie. Ce mode de commande est fréquent aux États-Unis : il en réduit le coût pour chaque interprète tout en permettant de proposer une belle rémunération au compositeur. Il se trouve que James Wood est un familier de l’Ircam (il y a composé Mountain Language en 1998), il m’a donc paru naturel de l’associer à la création française de la pièce. Autour de cette création s’est cristallisé le projet d’une série de commandes pour marimba et électronique. Toutefois, je tenais à ce que ce projet et les nouvelles œuvres qui en naissent soient repris et puissent être diffusés le plus largement possible : d’où l’idée de fédérer, outre l’Ircam, différents centres nationaux de création musicale du territoire français, associés chacun à un compositeur avec lequel ils ont des affinités. Ainsi les œuvres de Daniel D’Adamo (réalisée à Art Zoyd de Valenciennes, où il est en résidence, et au Césaré de Reims) et de Laurent Durupt (réalisée à l’Ircam) ont-elles vu le jour, ainsi que la mienne (à la Muse en Circuit). Il se trouve que j’avais, en 2014, été à l’origine d’une commande à Tôn-Thât Tiet. La rencontre avec cet homme hors du commun, d’une sagesse admirable, m’avait particulièrement touché, et je tenais à rejouer sa Balade, qui me semble un parfait pendant musical au Secret Dialogues de James Wood : très imagées, les deux œuvres se complètent, se distinguant des autres pièces de ce programme par un rapport au temps très particulier.
Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur le marimba cinq octaves ? Qu’est-ce qui fait à vos yeux la spécificité de cet instrument ?
La percussion est un instrument de notre époque. Elle n’a pas encore cent ans d’écriture soliste. Et le marimba encore moins. On le découvre en Europe dans les années 1980. Je me souviens en avoir vu pour la première fois alors que j’avais dix-sept ans. L’impression a été immédiate : la taille de cet instrument est extraordinaire. On sait d’emblée qu’on ne pourra jamais le dominer. Il est quasi impossible de jouer la note la plus grave et la note la plus aiguë en même temps… Depuis lors, j’ai suivi de près le travail de Keiko Abe, percussionniste japonaise qui a beaucoup développé le répertoire et les techniques du marimba. Moi qui suis fasciné par l’Asie, j’ai été séduit par la volonté des compositeurs japonais (comme Keiko Abe justement, ou Yoshihisa Taira) d’opposer au marimba une forme de densité avec un sentiment de légèreté, ainsi que par la gestion de l’énergie de la frappe, qui rappelle celle des arts martiaux. Depuis lors, j’ai passé, face au marimba, de longues heures de pratique et de questionnement pour en repousser les limites, mais aussi pour penser l’avenir de sa facture, de son design, de ses baguettes.
L’ambitus du marimba cinq octaves est passionnant – bien plus vaste que celui du vibraphone, par exemple. C’est l’un des instruments les plus graves de tous les claviers – aussi grave qu’un violoncelle – et cela ouvre des horizons sonores fascinants, que l’on ne trouve nulle part ailleurs parmi les instruments de percussion sinon les timbales. Dans les graves, on peut même faire sonner l’instrument sans que les attaques soient perceptibles, en trouvant le bon rythme pour travailler sur la vibration de la lame – c’est d’ailleurs un des aspects qui a beaucoup intéressé Laurent Durupt.
Les commandes que vous avez suscitées étaient-elles accompagnées de contraintes ?
La seule contrainte relevait de la logistique : je voulais que le projet puisse voyager, et que les pièces soient faciles à reprendre, qu’elles s’inscrivent rapidement et durablement dans le répertoire de l’instrument. Plus encore, je voulais que des étudiants puissent s’en emparer. Au départ, il ne devait donc y avoir sur scène qu’un marimba et l’électronique. Dans un second temps, nous avons imaginé la possibilité d’ajouter quelques instruments légers autour. Et si, pour la création des pièces, le dispositif électronique peut être complexe (avec éventuellement des traitements en temps réel, par exemple), les compositeurs ont également mis au point une version « légère » de l’électronique, afin que celle-ci ne soit pas un obstacle à la reprise des pièces. Cette version fonctionnera sur un équipement simple : un ordinateur doté d’une bonne carte son, des câbles, éventuellement un contrôleur MIDI et une paire d’enceinte. Tout marimbiste pourrait ainsi les reprendre, en faisant lui-même les branchements : à notre ère du « plug and play », ce genre de manipulations informatiques me semble accessible à toute personne désireuse de se lancer dans le métier de percussionniste et intéressée par le répertoire contemporain.
Comment travaillez-vous avec les compositeurs ?
J’ai déjà passé une vingtaine de commandes de pièces pour percussion solo. Souvent dans le cadre d’un projet particulier. J’essaie de travailler avec des compositeurs que j’aime ou avec lesquels je me sens des affinités. Le plus important est que le travail me grandisse. La relation, entre compositeur et interprète, représente pour moi la quintessence de notre métier de musicien. J’aime l’échange, la confrontation des idées. Chacun amène son bagage, son univers, et tout l’enjeu est de trouver un terrain d’entente sur lequel bâtir, sans nécessairement compromettre son esthétique propre. Je ne fais pas de démonstration de jeu en amont. Je n’interviens jamais sur le discours et les contraintes musicales. Mais je peux éventuellement servir de laboratoire, je peux proposer ou tester des solutions lorsqu’on me le demande. J’aime être un acteur de la création.
Un même projet, destiné à un autre, ne donnerait pas naissance à la même pièce ?
Non, je ne pense pas. Cela dit, il arrive parfois que les rencontres avec le compositeur soient rares et brèves – cela dépend énormément des personnalités. En ce qui concerne Laurent Durupt et Daniel D’Adamo, en revanche, nous nous serons vus à plusieurs reprises pour des sessions de travail de trois ou quatre jours afin de préparer leurs œuvres.

Comment James Wood, Laurent Durupt et Daniel D’Adamo ont-ils abordé le marimba ?
Je crois que le marimba est parfois une source d’angoisse pour les compositeurs : c’est certes un instrument magique par sa taille et son élégance, mais c’est aussi un instrument acoustiquement très nu, doté d’une résonance limitée. Je crois que Laurent Durupt et Daniel D’Adamo se sont tous deux demandés comment pallier cette lacune : comment le transformer en un instrument résonant ? James Wood, pas du tout. Même s’il joue beaucoup de silence – qui est aussi, à certains égards, une forme de résonance. Son œuvre est assez étonnante, avec cette mise en relation inattendue entre oiseaux et constellations.
Avez-vous également observé une diversité dans les approches de l’écriture pour l’instrument dans ses rapports avec l’électronique ?
J’ai le sentiment que Laurent, Daniel et moi-même nous sommes tous posés la question de la production de nouveaux sons : comment sortir le marimba de son identité « boisée » ? Daniel D’Adamo a ainsi imaginé un double marimba, comme un double de l’interprète, plus ou moins déformé ou perverti, qui se promène dans l’électronique. Laurent a, quant à lui, et tout comme moi, voulu travailler sur l’aspect percussif de l’instrument et la création de nouveaux modes de jeu (avec différents types de baguette, ou même avec les doigts…) pour dénaturer l’instrument alors même que celui-ci est présent dans la bande, dans une forme d’inversion contrintuitive.
Cette série a-t-elle un avenir ?
Je le souhaite : j’aimerais véritablement installer ce projet « marimba et électronique ». S’y ajoutera d’ailleurs très bientôt une nouvelle œuvre de l’Italien Daniele Venturi, et j’espère continuer à l’enrichir.